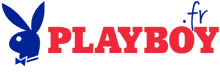Supercharged Flathead-Powered Ford Tudor Sedan’31
Je gribouille mes texticules (mes petits textes et pas mes testicules, bandes d’analphabètes radins), comme assis sur un tabouret pliant, un chapeau informe sur la tête et ma sébile aux pieds, près de ma canne, à coté de mon Cocker Blacky cancéreux en rémission… Je gribouille, sur des papiers d’emballages retirés de poubelles, mes commentaires qui mettent du vague à l’âme aux internautes qui passent, espérant leur soutirer un €uro en contrepartie d’un mois de lectures… J’ai en tête que :
“Le bon sens est la chose du monde la mieux partagée car chacun pense en être si bien pourvu que ceux même qui sont les plus difficiles à contenter en toute autre chose, n’ont point coutume d’en désirer plus qu’ils n’en ont”… Ce n’est pas repris d’un discours Politique d’Emmanuel Macron (né à Amiens/France en décembre 1977), ou d’Ursula von der Leylen-Albrecht (née à Ixelles/Belgique en ou de Volodymyr Oleksandrovytch Zelinsky (né en à Kryvyï Rih/URSS), mais de Descartes qui débute son “Discours de la méthode” par le constat que nul ne se plaint de sa bêtise…
 En effet, si on déplore toutes et tous, volontiers, le manque de force, de beauté, de richesse ou de mémoire, le manque d’intelligence, jamais… De fait, dans les contes dont on nous bassine en presse sous couvert de faux faits lorsque nos chefs/cheffes ont l’opportunité merveilleuse de nous raconter des bobards pour obtenir tout et n’importe quoi sous prétexte de l’intervention d’une puissance supérieure qui les habite, ce n’est jamais un supplément d’intelligence qui est réclamé mais toujours plus d’argent et d’or… On n’imagine pas que la bêtise dure indéfiniment. Il faut de plus n’être pas bête (en théorie) pour considérer que les autres le sont plus que soi-même ! Or, la bêtise consiste justement à taxer les autres de bêtise. L’intelligence, lorsqu’elle avance derrière le masque de la politique sous couvert de la culture, est loin d’être prémunie contre la bêtise, qui est une forme de négatif, une modalité du mal, qui n’a pas de contraire, qui apparaît indéfinissable si on ne part pas de l’intelligence, qui désigne à la fois une certaine faculté mentale et l’ensemble de ses résultats.
En effet, si on déplore toutes et tous, volontiers, le manque de force, de beauté, de richesse ou de mémoire, le manque d’intelligence, jamais… De fait, dans les contes dont on nous bassine en presse sous couvert de faux faits lorsque nos chefs/cheffes ont l’opportunité merveilleuse de nous raconter des bobards pour obtenir tout et n’importe quoi sous prétexte de l’intervention d’une puissance supérieure qui les habite, ce n’est jamais un supplément d’intelligence qui est réclamé mais toujours plus d’argent et d’or… On n’imagine pas que la bêtise dure indéfiniment. Il faut de plus n’être pas bête (en théorie) pour considérer que les autres le sont plus que soi-même ! Or, la bêtise consiste justement à taxer les autres de bêtise. L’intelligence, lorsqu’elle avance derrière le masque de la politique sous couvert de la culture, est loin d’être prémunie contre la bêtise, qui est une forme de négatif, une modalité du mal, qui n’a pas de contraire, qui apparaît indéfinissable si on ne part pas de l’intelligence, qui désigne à la fois une certaine faculté mentale et l’ensemble de ses résultats.
Il n’existe pas une faculté de bêtise comme il existe une faculté d’intelligence. Ce sont les défaillances de l’intelligence comme exercice de la pensée et produit de cet exercice qui déterminent la bêtise. Pour que l’intelligence prenne congé (jamais définitivement au demeurant), il faut qu’elle existe en liberté. L’animal, de ce fait, n’est jamais bête, lorsqu’il nous paraît tel, c’est parce que nous le plaçons dans des situations auxquelles il n’est pas adapté par instinct. Le manque d’intelligence ou de jugement ne signifie pas leur complète absence : tout homme manifeste un certain degré de lucidité dans des circonstances et dans un contexte donnés. Et puisque l’intelligence peut se perfectionner dans le temps historique, des conduites naguère adéquates peuvent finir par devenir des signes de bêtise (inadaptation entre la pensée et la réalité, ou entre l’action et la réalité). L’opposition entre l’intelligence et la bêtise se marque à une série de dualités : adaptation/inadaptation, inventivité/répétition, concept/idée générale, souci d’objectivité/incapacité à sortir de soi.
Alors que l’intelligence est inventive, stimulée par la nouveauté qu’elle est elle-même capable de créer par ailleurs, la bêtise est compacte, stagnante, elle s’englue dans les choses, et fuit le temps. Elle est la pensée devenue mécanique, le corps changé en automate. Elle transforme la vie en machine à tics. De là son pouvoir comique, plaqué sur le vivant. Avec la bêtise, on tombe plus bas que l’homme, d’où l’usage des métaphores objectales. La bêtise est à l’aise dans ce qui ne change pas ; elle est conservatrice par nature, elle voudrait arrêter la durée et l’existence, aussi déteste-t-elle tout ce qui fait échec à la stabilité des choses et des êtres : la contradiction, le hasard, l’aventure, la complexité. Elle agit comme une force d’inertie, et n’offre aucune prise à ses adversaires (lesquels enragent de ce fait). Elle est principe de régression : la bêtise est involutive. Ses formes d’expression sont stéréotypées (proverbes, lieux communs, clichés, préjugés, rumeurs …). Les étiquettes remplacent les mots et les opinions toutes faites…
La bêtise est doxocentrique. Elle se sent chez soi et elle y reste. “L’Autre” représente pour elle une menace, elle le hait comme une liberté qui lui échappe. C’est face à lui que la bêtise (tout comme l’intelligence d’ailleurs) devient une force sociale. La bêtise a des idées, mais de travers. Comme on avale de travers, elle pense de travers. Elle fait usage d’idées générales qui sont au concept ce que le bruit est à la musique. Elle est incapable d’universel véritable, ce que traduit l’étymologie grecque du terme d’idiot. La catégorisation à laquelle elle procède affecte d’abord les groupes humains : ainsi chaque peuple sera-t-il caractérisé par un adjectif. La bêtise extrapole jusqu’à une apparence d’universalité qui raffole des adverbes superlatifs. Le consentement à la bêtise est l’une des lâchetés ordinaires auxquelles il est le plus difficile d’échapper. Le collègue de travail qui ne rirait pas après avoir entendu une blague machiste ou raciste montrerait par là une intolérable prétention. Il existe même un despotisme de la bêtise (l’usage du salut hitlérien en fut un exemple caricatural)…
Il désigne aussitôt, sans même la médiation de la parole, les exclus du groupe. La bêtise peut être cultivée, au sens d’entretenue. Les totalitarismes l’incarnent. Mais il existe aussi une bêtise démocratique, qui s’exprime par des mots et des valeurs de consensus. Lorsque le journaliste de la télévision annonce “un grand moment d’émotion” ou que l’homme politique affirme qu’il n’a de leçon à recevoir de personne, ils provoquent des stimuli analogues aux sonneries qui annoncent les repas ou la fin des cours. Si la bêtise ne faisait pas jouir, elle ne serait pas si répandue. La bêtise exerce toujours un certain pouvoir, parfois elle l’a, suprême, c’est le pouvoir du mal et c’est la raison pour laquelle on ne saurait réduire la bêtise à un problème d’esthète, car la bêtise fait davantage que des fautes de goût. Et si elle nous rend honteux d’être des hommes, c’est parce que les guerres et les génocides sont ses plus abominables expressions. Dans une société individualiste de masse comme l’est la nôtre, tentée à la fois par l’éparpillement des idées et des esprits et par le consensus.
Les lieux communs sont un moyen de faire ou de refaire du lien. Avec le lieu commun : “Je ne suis plus seul”... La bêtise tient chaud, et donne du cœur à l’ouvrage. Le nombre n’est-il pas un critère suffisant de certitude ? Le vieil argument du consensus traîne toujours implicitement : “Ce que je pense est vrai puisque tout le monde le pense !”… On comprend dès lors pourquoi le lieu commun signale l’âge démocratique des sociétés. Dans les sociétés aristocratiques d’ancien régime, une expression toute faite ne dépassait guère la sphère étroite d’une caste. Le peuple disposait de proverbes dans la mesure même où il n’avait pas la parole. Nul étonnement dès lors qu’avec la prise de parole caractéristique de l’âge démocratique, les proverbes tendent à disparaître : de fait, aujourd’hui il n’y a plus guère que les vieux pour en rappeler un de temps en temps, les jeunes générations ne connaissent plus les proverbes (pas davantage les dictons). Le lieu commun peut donc être compris comme le substitut du proverbe et aussi, comme le remplaçant de la citation…
Une sociologie du langage pourrait en étudier la disparition… Notez que contrairement à ce que presque tous les philosophes, depuis Platon, ont soutenu, un lieu commun n’est pas nécessairement faux. Il arrive en effet que l’opinion publique ait raison, même contre les ricanements et les critiques d’intellectuels… Au siècle des Lumières, Rousseau fut à peu près le seul à pressentir l’existence des périls que l’intelligence pouvait faire peser sur l’être humain. L’intelligence produit volontiers du mal social : humilier, exploiter l’autre, le tuer est très loin d’être l’apanage de la bêtise. L’intelligence a légitimé et forgé la servitude aussi sûrement que l’émancipation. De plus, que peut valoir l’intelligence dès lors qu’elle ne protège ni de l’inculture ni de la vulgarité, ni même, comme on l’a vu, de la bêtise ? Mise au service du pouvoir, d’une volonté de puissance qui n’a rien de nietzschéen, l’intelligence peut être plus redoutable que la bêtise. Nombre de désastres dans l’Histoire ont été provoqués par des gens intelligents.
Nietzsche disait qu’avec la connaissance l’humanité disposait désormais d’un formidable moyen pour se détruire. La technoscience moderne nous montre assez quels désastres les sciences et les techniques les plus sophistiquées sont capables de provoquer. Mais, n’est-ce pas là, justement, le signe de la plus inquiétante bêtise ? L’homme est capable de déployer des trésors d’intelligence au service de fins ineptes. Devant la puissance désormais immaîtrisable des techniques modernes, l’être humain n’est plus en mesure de penser ce qu’il fait. Telle est la banalité du mal, ne plus pouvoir penser ce que l’on fait. Mais qu’est-ce donc que la bêtise, sinon l’absence de pensée ? Conclusion : l’intelligence abêtit l’humanité à un degré inédit. Un tel contraste est également constatable dans la sphère économique, et est de nature à relativiser les indignations traditionnelles. Que représente une sottise proférée étourdiment, et dénoncée (non sans jubilation) par l’esthète, à côté de la bêtise profonde de l’ambition et de la cupidité qui mènent le monde actuel ?
Oui, la bêtise existe bien, mais pas d’abord chez ceux dont on avait l’habitude de rire depuis Aristophane. La bêtise de la “prose du monde” (pour reprendre l’expression de Hegel) est autrement inquiétante, elle a la force des techniques d’armement, de surveillance et de contrôle les plus puissantes, celle des mathématiques financières, et c’est dans le sens de la destruction qu’elle va : dévastation de l’environnement, délitement de la société et, pour finir, liquidation de l’être humain lui-même. Quel plus grand mal pourrait-on concevoir ? Ne pouvant, seul, rien y contrer ni faire d’autre que d’en écrire sachant que “tout un texte n’est jamais lu, à peine parcouru”, j’habille mes réflexions sous le couvert d’histoires débilitantes digérables au “Vulgum Pecus” par le leurre d’une histoire mise en parallèle en imbrications imagées… Je devine que pas même 5% liront ce qui précède d’autant plus que le descriptif de l’objet “leurre” de présentation n’est accessible que si abonné… Quelle perversion m’habite donc de vous en priver sans remplir ma sébile… Un €uro… Pfffffffff !
Cette Ford Tudor Sedan’31 a été modifiée par son précédent propriétaire : châssis “caissonné” sur mesure, toit abaissé, intérieur personnalisé et transmission remplacée. Elle est propulsée par un V8 Mercury à soupapes latérales de 255 ci (4,2 L) suralimenté par un compresseur McCulloch, couplé à une boîte manuelle Tremec à cinq rapports. La carrosserie en acier a été repeinte en vert et noir lors de sa restauration, achevée en 2013. À l’extérieur, on note un compartiment moteur apparent, une visière de pare-brise, des feux arrière intégrés et des custodes de style coupé à cinq fenêtres. L’équipement comprend également un collecteur d’admission Offenhauser, deux carburateurs Holley, des culasses Evans, des collecteurs d’échappement de type “lake”, des tambours de frein à ailettes de type Buick, un répartiteur de freinage Wilwood et des jantes décalées de type “artillerie”. Acquise il y a un demi siècle, cette Tudor Sedan transformée en Hot Rod circule réglementairement avec une immatriculation de l’État de New York, attestant qu’il s’agit d’une Ford’31.
La carrosserie en acier a été repeinte en vert et noir après des modifications comprenant la suppression d’une partie du toit, l’intégration de vitres de custode courtes de type coupé cinq fenêtres et de feux arrière intégrés, le remplacement du plancher et la suppression du capot, des ailes et des marchepieds. Elle est également dotée de liserés noirs, d’une visière de pare-brise, d’un pare-brise inclinable, de deux rétroviseurs extérieurs et d’un bouchon de réservoir à ouverture latérale. Les roues de type artillerie, de 16 pouces à l’avant et de 15 pouces à l’arrière, sont dotées d’enjoliveurs chromés et chaussées respectivement de pneus Coker Classic 5.50-16 et de Firestone Dragster Cheater Slicks 8.20-15. Le châssis a été renforcé par des traverses tubulaires. La suspension est composée de ressorts à lames transversaux, d’un essieu avant en I perforé et de barres de traction à l’arrière. Le freinage est assuré par des tambours à ailettes aux quatre roues, associés à un répartiteur de freinage réglable Wilwood.
L’habitacle est équipé de sièges baquets à l’avant et d’une banquette arrière revêtue de vinyle marron qui se prolonge sur les portières et les panneaux latéraux. Le tableau de bord, provenant d’une Ford de 1953, est noir avec des touches de vert. Parmi les autres équipements, on trouve un indicateur de feux tricolores, des pédales polies, des ceintures de sécurité ventrales et un levier de vitesses sur mesure surmonté d’un pommeau en forme de microphone. Le volant à deux branches fait face à un compteur de vitesse hors service gradué jusqu’à 160 km/h et à un compte-tours AutoMeter gradué jusqu’à 7.000 tr/min. Le compteur kilométrique à cinq chiffres affiche 2.100 km, dont environ 320 km parcourus par qon heureux propriétaire. Le kilométrage réel est inconnu. Le V8 à soupapes latérales de 255 pouces cubes (4,2 litres) proviendrait d’une Mercury de 1950 et est équipé d’un compresseur McCulloch, d’un collecteur d’admission Offenhauser, de deux carburateurs Holley 94, de culasses Evans et d’un allumage magnétique Mallory.
Il y a aussi des collecteurs d’échappement de type “lake” isolés. Un carter en aluminium Hildebrandt abrite un filtre à huile vissable déporté, et un démarreur électrique Moore’s Auto Electric a été installé, ainsi qu’un radiateur en aluminium avec ventilateur électrique. La puissance est transmise aux roues arrière par une boîte de vitesses manuelle Tremec à cinq rapports et un pont arrière Ford 9po avec un rapport de 3,55:1. Un embrayage hydraulique Wilwood est relié à un ensemble d’embrayage de 10,5po, et un réservoir de carburant en aluminium de 12 gallons est monté derrière la banquette arrière. Les photos supplémentaires du dessous de la voiture ont été perdues. La voiture n’a pas de carte grise, car elle est immatriculée dans un État qui n’en délivre pas pour les véhicules de cet âge. Elle est vendue avec son immatriculation New-Yorkaise transférable… Voilà, j’en ai terminé… Je vais compter les pièces de ma sébile pour nourrir mon Cocker Blacky puis nous irons compter les étoiles du ciel…