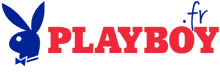Darkness !
Ahhhhhhhhhhhhhhh ! J’en viens ! j’y viens !… Non pas à “la solution finale”, celle utilisée par les Nazis, réutilisée depuis quelques années à Gaza (des centaines de milliers d’enfants, de femmes, d’hommes, d’humains, “génocidés”) mais à celle qui fut le socle du colonialisme blanc dans le monde… (des centaines de millions d’enfants, de femmes d’hommes, d’humains, “génocidés”)… Au bon milieu du XVIII e siècle, Voltaire, dans son Dictionnaire philosophique, faisait la remarque suivante (non sans une certaine dose d’ironie malicieuse) : “Ô ! Ô ! Le Beau n’est pas le même pour les Anglais et les Français ! “... Il est évident qu’au sujet d’une notion aussi discutable et relative que le Beau (ou to kalon, en grec), de même que pour tout ce qui tient au concept plus général d’esthétique, il est souvent arrivé que les ”Her Majesty’s subjects”, situés du mauvais côté du “English Channel” et les braves citoyens Franchouillards de l’Hexagone (qui eux, habitent du bon côté de la Manche), n’ont pas toujours partagé les mêmes opinions, ou, au moins, c’est ce que Voltaire écrivait…
Certes, si nous passions soudain au-delà de la célèbre ironie Voltairienne, nous nous apercevrions qu’il s’agissait, dans les écrits du grand philosophe, d’une originale et joyeuse plaidoirie pour l’idée de tolérance, qui occupait une place dans la philosophie des Lumières. Une interrogation reste cependant valable, de nos jours encore : “En est-il de même de toutes les notions, soient-elles esthétiques, philosophiques, littéraires, critiques, culturelles, socio-historiques ? Seraient-elles si différentes sur les deux rives de la Manche ? Y aurait- il un si grand et énorme voire insondable écart depuis Calais et jusqu’à Dover ?”… Certes, non, si nous nous rapportons aux deux auteurs que je vais citer dans quelques lignes, en quelques mots. Ce propos, cette étude, vise à démontrer de manière présomptueuse, j’en conviens d’avance, que, autant Louis–Ferdinand Céline que Joseph Conrad, nourrissaient sans conteste l’un et l’autre, dans un sentiment quasi-identique vis-à-vis de ce qu’ils appelaient “Nuit/noirceur/obscurité”… N’est-ce pas là le “Darkness de l’existence ?
Afin de mener à bonne fin ma démarche argumentative, dans un espace si restreint que cet article, je dois limiter mon analyse à deux écrits seulement : le roman “Voyage au bout de la nuit”(1932), et la nouvelle “Heart of Darkness/Cœur des ténèbres” (1902)… Pour commencer, je dois définir les notions de “Noirceur” dans le cas de Céline et de “Darkness” chez Conrad. En fait, ni le terme utilisé pour Céline, ni celui de Conrad ne sont des notions ou des concepts dans une acception strictement philosophique, de même, aucun des deux auteurs ne se prétend philosophe ou créateur d’un système cohérent de pensée. Cependant, la “noirceur” pour Céline, et le “darkness” pour Conrad, restent des mots- clés, des outils de base dans l’interprétation critique de leurs écrits : ils constituent “l’axis mundi” autour de laquelle se bâtissent leurs univers fictionnels. Il s’agit d’une frappante similitude des philosophies de vie développées par les deux prosateurs contemporains, en dépit d’une distance de trente ans qui sépare leurs textes (Conrad, 1902 et Céline, 1932).
Leurs visions du destin de l’être humain dans l’univers sont marquées d’un noir pessimisme. En essayant de faire l’anamnèse de ce symptôme, sa source est à trouver, d’une part, dans le rapport de l’écrivain au monde extérieur, et d’autre part, dans la relation avec son propre “moi” qu’est le monde intérieur. Dans un cas, comme dans l’autre, ce rapport est toujours décevant, déprimant, désabusant et il mène inévitablement à une image très sombre du misérabilisme de l’humain. Et, de plus, dans les deux cas, cette perspective est d’une rare noirceur (darkness)… Chez Céline, dans son “Voyage au bout de la nuit”, le ton est donné d’emblée, depuis la petite strophe placée en épigraphe à son roman : “Notre vie est un voyage / Dans l’hiver et dans la Nuit / Nous cherchons notre passage / dans le Ciel où rien ne luit” (Chanson des gardes Suisses de 1793). A un niveau supérieur de généralités philosophiques et existentielles Céline écrit : “La vie c’est ça : un bout de lumière qui finit dans la nuit. Et puis… peut-être qu’on ne saura jamais, qu’on ne trouvera rien… C’est ça la mort”.
Une vision semblable s’exprime, avec un désespoir modéré (à l’anglaise), chez Conrad, dès les premières pages de sa nouvelle “Heart of Darkness”(Cœur des Ténèbres) : “Nous vivons dans un clignotement de la lumière, qui dure aussi longtemps que la vieille Terre continue à tourner ! Mais l’obscurité était là, hier. L’Homme est forcé de vivre au milieu de l’incompréhensible, qui est également détestable. Et cela comporte aussi une certaine fascination, qui s’exerce sur lui. La fascination de l’abomination”)… Il est important à remarquer que les deux auteurs ont écrit leurs textes respectifs suite à des voyages qu’ils ont entrepris, et les ont profondément marqués. Pour Céline, il s’agit, d’abord entre 1914-1915 de la traversée d’une Europe ravagée par la Première Guerre mondiale et d’une malheureuse expérience sur le front des Flandres : le Maréchal des Logis Destouches, âgé de 20 ans seulement, est gravement blessé, près de Comines (“Noirceur” dans son livre) ; ensuite, vient le voyage en Afrique, dans le Cameroun, où il vit et décrit les noirceurs et la fascination de l’abominable…
Céline travaille pour la compagnie forestière de Sangha-Oubangui, à Bikomimbo (entre 1916-1917) et, finalement, il arrivera jusqu’aux Etats-Unis, où il participera à une mission médicale de la SDN (en 1925)… Quant à Conrad, l’auteur britannique (d’origine polonaise, né dans l’Ukraine russe), devenu ‘Master Mariner’ dans la flotte britannique, entreprend, en 1890, une expédition en Afrique noire, au Congo, en naviguant dans une petite embarcation sur le fleuve homonyme. Dans les deux cas, leurs voyages s’avèrent des expériences négatives, décevantes et traumatisantes à la fois ; chez tous les deux, la cause des désordres intérieurs est liée au vécu des auteurs, à ce qu’ils ont vu, ouï, senti, éprouvé, au cours de leurs pérégrinations et aux constats que cette expérience personnelle engendre dans leurs esprits : “Le scandale du colonialisme et de ses effets à long terme, doublé par cet épiphénomène du désir de dominer le Monde, qui est la décadence et la déshumanisation de l’Homme”.
À la première vue, le lecteur pourrait croire que la noirceur/darkness de cet univers fait strictement référence au Continent Noir et aux injustices du système colonial ; certes, les deux récits se déroulent sur une toile de fonds qui se tisse à partir de ces circonstances socio- historiques précises. En fait, autant Céline que Conrad accusent (indirectement) les traces profondes, laissées sur le sol noir et les peaux noires de l’Afrique noire par les “civilisateurs” à la peau blanche ; mais, en même temps, saisis d’un fort besoin d’objectivité, ils n’épargnent pas non plus les autochtones, leur ôtant toute l’aura idyllique des “bons sauvages”… Céline, dont le tracé parcourt une grande partie du monde, constate, à grand désarroi, que l’humanité est partout pareille et que l’exploitation et la misère sont des compagnes familières de l’Homme. Son héros, Ferdinand Bardamu, enrôlé volontaire pour la guerre, découvre ce qu’il va appeler la “roublardise immense” qui se déroule derrière le front, où les puissants font fortune sur le compte de ceux qui se sacrifient dans les tranchées.
Cela rappelle une boutade de Rabelais, qu’il a formulée à propos de la guerre Picrocholine : “Les uns mourraient sans parler, les autres parlaient sans mourir” écrivait-il dans son Pantagruel. Ca va, vous suivez le rythme, vous ne décrochez pas encore ? Ensuite, arrivé au Cameroun, Bardamu constate l’exploitation, indiscriminatoire, des indigènes Noirs et des Blancs pauvres, dans l’une des “Factories” de la Compagnie Pordurière (en fait, le nom même de l’honorable entreprise parle de soi : le mot-valise “Pordurière” est évidemment formé des mots “portuaire” et “ordure”). Afin d’effacer toute suspicion concernant un prétendu racisme de Céline (sentiment qui est complètement absent de ce roman), voici le portrait des employés blancs, brossé, avec une brillante ironie, par l’auteur : “Je m’aventurais de temps en temps jusqu’aux quais d’embarquement pour voir travailler sur place mes petits collègues anémiques que la Compagnie Pourdurière se procurait en France par patronages entiers”…
Il continue en crescendo : “Une hâte belliqueuse semblait les posséder. Ils asticotaient les débardeurs noirs avec frénésie. Zélés, ils étaient, sans conteste, et tout aussi lâches et méchants que zélés. Des employés en or, en somme, bien choisis, d’une inconscience enthousiaste à faire rêver”… Même si la mentalité de ces gens reste celle des Européens civilisés venus de la métropole(et, par cela, ils pensent avoir un statut supérieur par rapport à celui des autochtones), Céline met en évidence le fait qu’ils sont tout aussi exploités que les Noirs, et que leur situation n’est pas très loin de l’esclavage : “Ils étaient venus en Afrique tropicale, ces petits ébauchés, leur offrir des viandes, aux patrons, leur sang, leurs vies, leur jeunesse, martyrs pour vingt-deux francs par jour, contents, quand même contents, jusqu’au dernier globule rouge guetté par le dix millionième moustique”… Le même principe de “presser l’orange et en jeter l’écorce”, se retrouve aussi mis en pratique au-delà de l’océan, dans “le pays de toutes les possibilités”…
La zone industrielle américaine, celle des usines Ford, à Detroit, nous plonge dans un univers ténébreux, de sueur et de labeur, où l’exploitation indiscriminatoire des deux races n’est point meilleure que celle des colonies. Quant à Conrad, il se rend compte que la cupidité est un trait inhérent, constant et éternel de l’Homme, et que c’est cela qui fait bouger le Monde : “C’est cela qui se trouve à la base de toute entreprise de notre race”… En parlant des temps anciens de l’Humanité, et en les comparant aux temps modernes, il observe que, dans les deux cas, l’image est la même : “Eux, les anciens, ils étaient des conquérants, et, pour cela, on n’avait besoin que de la force brute puisque le pouvoir physique n’est qu’un accident né de la faiblesse des autres. Ils empoignaient tout ce qu’ils pouvaient empoigner, pour ce qu’il y avait à gagner. C’était le larcin pur et dur, avec violence, aggravé par le meurtre à grande échelle, et les hommes s’y livraient, aveuglement. C’est le propre de ceux qui se précipitent dans les ténèbres”..
Pour l’auteur anglais, si l’Humanité a évolué aux niveaux scientifique et technologique depuis les commencements du monde, l’Homme, en revanche, est resté, fondamentalement, le même : il est tourmenté par les mêmes fantasmes, angoisses et les mêmes passions destructrices et égoïstes , il vit immoralement dans la même noirceur ‘darkness’ que nos ancêtres…“La conquête du Monde, qui signifie, en principal, l’arracher à ceux qui ont une autre couleur de la peau, ou des nez un peu plus larges que les nôtres, c’est pas joli du tout, si l’on regarde tout ça de près. Ce qui nous sert, nous, c’est l’efficacité”… Le grand moteur du progrès matériel de la société est donc, selon Conrad, ce que l’on appelle, savamment, “l’efficacité”, et qui peut se réduire, en principal, à deux verbes : Conquérir et exploiter… Mais l’aspect le plus triste, dans l’impérialisme moderne, c’est l’hypocrisie, qui vient doubler les fraudes et les actes violents : non content de voler et d’assujettir par la force, le conquérant moderne veut encore se couvrir des vêtements de la vertu…
Noirceur et fascination de l’abominable… Céline, en début de l’épisode africain de son roman, nous décrit l’enthousiasme naïf de son héros, Ferdinand Bardamu, qui, avant de partir dans son aventure Camerounaise, s’imagine une Afrique mirifique, mystérieuse, et semble inviter le lecteur à partager un songe exotique et captivant : “Ah ! L’Afrique, la vraie, la grande ; celle des insondables forêts, des miasmes délétères, des solitudes inviolées !”. Cette image initiale va former un contraste frappant avec la réalité réelle, horrible, douloureuse, celle qu’il va découvrir lorsqu’il met effectivement les pieds sur le sol africain. Après avoir été assailli par des moustiques, des rats, des scorpions, des chauve-souris et des serpents, tout le long d’une nuit interminable à Fort-Gono, il annonce victorieusement l’arrivée salutaire de l’aube, qu’il célèbre par les phrases suivantes, où il fait entrer, avec sa profonde déception, le désespoir poignant du prisonnier : “Le lendemain vint, quand même, cette chaudière. Une envie formidable de m’en retourner en Europe m’accaparait le corps et l’esprit”…
Il poursuit, survolté : “. Il ne manquait que l’argent pour foutre le camp. Ça suffit. On n’était pas bien, aux colonies”. Natures sensibles et quasi-inadaptables à la laideur de la vie et à la double agression des choses naturelles et des êtres humains, Céline et Conrad essaient cependant d’y tenir tête en s’entourant d’une muraille protectrice ; par conséquent, tout un arsenal d’autodéfense est mis en place, pour secourir leur fragile intériorité : ironie (amère ou mordante), sarcasme cinglant, remarques cyniques, moquerie malicieuse, humour noir etc. Voici, pour exemplifier, un échantillon de la fameuse ironie célinienne, lorsqu’il parle des “bienfaits” du colonialisme sur le sol africain : il suggère la ruine physique et la détresse généralisée du pays, en contraste frappant avec l’opulence coloniale : “Le plus grand bâtiment de Fort-Gono, après le Palais du Gouverneur, c’était l’Hôpital. Je le retrouvais partout sur mon chemin ; je ne faisais pas cent mètres dans la ville, sans rencontrer un de ses pavillons, aux relents lointains d’acide phénique”.
L’ironie célinienne est évidemment ciblée contre les colonisateurs blancs, cette même arme impitoyable est braquée, également et sans aucune discrimination, sur les Noirs et leurs mœurs : “Le petit nègre, mon guide, revenait sur ses pas pour m’offrir ses services intimes ; et, comme je n’étais pas en train ce soir-là, il m’offrit, aussitôt, déçu, de me présenter sa sœur. J’aurais été curieux de savoir comment il pouvait la retrouver, sa soeur, dans une nuit pareille”… Sans doute, l’ironie se double-t-elle ici d’une tristesse sous-entendue, parce que, si les indigènes sont parvenus à un tel état de décadence (matérielle et morale), ce n’est pas uniquement de leur faute : la misère et l’indigence, conséquences du colonialisme, les ont amenés à commercialiser tout ce qu’ils possèdent, c’est-à-dire, en principal, leur corps. Il ne s’agit donc pas seulement d’un laxisme comportemental des Noirs, ou d’un immoralisme pur et dur de leur part, mais plutôt d’une manière de gagner leur vie, dans les conditions de la pauvreté et de la déprime.
La misère matérielle va de pair avec celle morale et, toutes les deux, sont des épiphénomènes d’un vide éducationnel qui aurait dû être comblé par les Blancs “porteurs de la civilisation”. Quant à Joseph Conrad, il est, lui aussi, un maître de l’ironie, du sarcasme et de l’humour noir à l’anglaise, comme on peut le voir dans l’épisode de la discussion entre les Blancs et les cannibales. Naviguant sur le Congo, dans une embarcation à vapeurs assez primitive, Marlowe embauche quelques indigènes pour l’aider ; mais leur petit bateau est attaqué par les tribus sauvages qui habitent les rives du fleuve. Après avoir repoussé, à grande peine, ces attaques, aidé par les Noirs qui se trouvaient au bord du navire, Marlowe reste tout à fait interdit lorsque le chef de son équipage lui demande la permission de ramasser et de manger les hommes tués sur les rives. La justification donnée par le cannibale est qu’ils ont, tous, terriblement faim. Conrad fait alors, par la bouche de son personnage–narrateur, cette remarque, émaillée d’une mordante ironie à l’anglaise…
“Pourquoi, au nom de tous les diables affamés, ne nous ont-ils pas attaqués, ils étaient trente contre cinq et l’idée m’est venue à l’esprit… Comme ils avaient l’air délabrés, ces pèlerins, j’espérais que mon aspect à moi n’était pas tellement non appétissant”… Le pessimisme le plus sombre est l’état d’esprit dominant, autant chez Céline, que chez Conrad ; la noirceur / the darkness vient – au moins en partie – d’une quête désespérée et inutile du sens de la vie. Dans le cas de Céline, l’on peut constater que son inadaptabilité au monde engendre en lui le malaise qui, devenu permanent, le conduit à un dégoût irrépressible, à un état de nausée face à l’univers concret dans son ensemble et sous toutes ses formes matérielles : les règnes minéral, végétal, animal, de même que l’espèce humaine lui provoquent une égale répulsion. D’où son insistance maladive, presque masochiste, sur les moindres détails d’une matière en décomposition, en putréfaction : ordures, excréments, immondices, déchets, auxquels s’ajoutent d’autres éléments dégoûtants comme la boue et la salissure.
D’autre part, il manifeste une véritable phobie, qui va jusqu’à la névrose, vis-à-vis des insectes, des petits animaux, et, surtout, des hommes. (Probablement, un psychanalyste trouverait facilement une explication scientifique à toutes ces manifestations exacerbées du dégoût et qualifierait, sans doute, notre auteur, de “sexuellement frustré”… Dans le cas de Conrad, les sentiments qu’il éprouve pour la race humaine sont un curieux mélange de mépris et de pitié à la fois ; mais, à la différence de son confrère français, il n’est jamais dégoûté par la Nature, pour laquelle il montre un respect et une condescendance qui n’excluent pas l’effroi ou la dévotion. La nature est, chez lui, toujours puissante, majestueuse, comminatoire, dangereuse et fascinante en même temps ; elle est supérieure à l’homme et, même s’il en a peur parfois, il n’oserait jamais la haïr ou la mépriser. Elle reste pour lui impénétrable, mystérieuse et pleine de secrets indéchiffrables, mais surtout noire, ténébreuse, ‘dark’, tout comme l’esprit humain.
La croisière de Marlowe sur le Congo se transforme dans une quête fiévreuse du mystérieux Kurtz, un explorateur blanc travaillant pour la Compagnie, disparu dans la vaste forêt tropicale. À la fin de cette expédition, Marlowe trouvera enfin un Kurtz qui ne ressemble nullement à la légende qu’on lui avait forgée ; c’est quelqu’un qui se croit et fait croire aux indigènes d’une tribu lointaine qu’il est une sorte de dieu, de divinité toute-puissante, alors que, en fait, il amasse et entasse des quantités énormes d’ivoire, qu’il thésaurise inutilement : c’est l’absurdité pure et dure des habitudes civilisationnelles de l’homme blanc, qui, décontextualisées, perdent toute logique. Ce Kurtz, que Marlowe retrouve après tant d’efforts, n’a rien à voir avec l’explorateur tenace et téméraire dont Marlowe avait tant entendu parler : il est, en fait, un paillasse, un prestidigitateur tout au plus, qui profite de l’ingénuité des indigènes pour se faire adorer comme un dieu païen ; mais il n’est qu’un un braconnier qui pille les ressources incontrôlables et encore riches du Continent Noir…
Si l’auteur, à travers Marlowe, se montre scandalisé par les habitudes des Noirs cannibales (bien que, eux, au moins, tuent pour manger), personne ne semble, en revanche, se soucier des crimes de Kurtz, ou des centaines d’animaux assommés par les trafiquants d’ivoire, qui sont considérés des hommes d’affaires absolument honorables. Lorsque Kurtz, malade et presque fou, meurt sous les yeux de Marlowe, il n’a qu’une seule phrase à dire, qu’il répète machinalement, comme une poupée abîmée, le regard fixé sur une image cauchemardesque et invisible : “L’horreur! L’horreur!”... Il confirme ainsi, une fois de plus, à quel point l’esprit humain est impénétrable et ténébreux, comme la forêt africaine. Le désespoir de Kurtz au seuil de la mort est aussi celui de l’incroyant, qui est terriblement surpris de constater que lui aussi il doit mourir, comme tous les autres, lui, qui se croyait une sorte de Dieu immortel ! Après une vie où il s’est battu pour la domination (la tribu qui l’adore) et la prospérité (les piles d’ivoire), il a du mal à accepter…
Même à l’extrême minute, qu’il est temps de s’en aller et de laisser tout cela derrière lui… C’est la première (et dernière) fois qu’il regarde au fond de lui-même et qu’il doit affronter sa (sombre) conscience. Mais ce qui l’épouvante le plus c’est l’absence d’un signe de la Divinité, chose reflétée dans le silence mystérieux de la forêt noire, qui semble ratifier à jamais le pacte du mourant avec le Néant… Cela est comme pour Thomas Buberl CEO d’AXA qui s’est fourvoyé dans le vol de ma LéaFrancis et l’escroquerie y incluse de par des avocats et magistrats totalement pourris qui collaborent à une escroquerie, en créant et réalisant et utilisant des faux en bande criminelle organisée… Je me dois d’en apporter plus à la connaissance et dévoilant certains pans et textes de l’histoire… Je vais m’y atteler et livrer les secrets enfouis, vous les décortiquer soigneusement pour en révéler les travers cachés qui grouillent de nauséabonds secrets… Et ils sont loins des SecretsInterdits de ce web-site…
Pour conclure cette analyse comparative, je peux affirmer que l’écriture de Céline, comme celle de Conrad… ainsi que la mienne, est chacune empreinte d’un noir pessimisme quant à la race humaine et au destin de l’Homme, dans un univers profondément ténébreux, autrement dit, ‘darkness’. Le Monde est pour ces deux auteurs un lieu sombre et la vie humaine n’est qu’une piteuse aventure, une traversée de la nuit, qu’aucune lueur d’espoir ne vient éclairer ; dans cet univers impitoyable, l’homme n’est qu’un jouet du destin. Et ce destin adverse va toujours en contresens de ses espoirs. Chez Conrad, comme chez Céline, la noirceur/‘darkness’ est la clé de voûte qui soutient l’édifice fictionnel tout entier. Dans sa nouvelle, Conrad attribue aux ténèbres de la forêt africaine une valeur symbolique : elles représentent en fait, la condition humaine ; la trame n’est qu’un prétexte pour développer une philosophie personnelle et pour nous faire part de quelques interrogations graves, profondes, inquiétantes, qui tourmentent l’âme humaine, depuis la nuit des temps .
Quel est le sens notre existence ? Y a-t-il quelque chose après la mort ? Et si oui, alors, qu’est-ce que l’au-delà nous réserve ? Si non, alors pourquoi sommes- nous des êtres doués d’intelligence et de sensibilité ? Qu’est-ce qui peut faire valoir notre vie ?… La réponse de Conrad semble se trouver dans la dernière phrase de Kurtz : “L’horreur ! L’horreur !” Cette exclamation nous paraît inachevée, et on pourrait la compléter, probablement, ainsi : “L’horreur… c’est qu’on ne peut jamais rien savoir : ni déchiffrer les secrets de la Nature, ni lire dans le regard d’autrui, ni pénétrer les hauts mystères métaphysiques”. Conrad semble clore son livre sur les positions d’un l’agnosticisme résigné. Quant à Céline, sa philosophie de vie peut se résumer, en fait à l’idée que le rapport de l’Homme au monde (intérieur ou extérieur) est toujours décevant. À l’origine de cette vision pourrait se trouver une déception métaphysique, causée par la relation sans espoir entre l’être humain, fragile et mortel, et une Providence toujours absente.
L’absurdité de cet univers vide débouche sur une sensation de nausée existentielle (au sens Sartrien) et sur un dégoût indiscriminatoire de tout et de tous, de l’univers en son ensemble, y compris de son locataire temporaire : l’être humain. Tous les deux auteurs ont été accusés de misanthropie, et il y a vraiment peu d’arguments pour contredire le bien-fondé de cette affirmation ; nous nous limiterons à dire que, dans les deux cas, la haine de l’Humanité vient d’un trop grand amour pour les hommes. Presque tous les misanthropes sont des humanistes désappointés. Les deux livres analysés sont construits autour de l’idée du voyage, qui est toujours riche en ressources fictionnelles. Chez Céline, le “Voyage au bout de la nuit” est le passage de l’être mortel à travers cette existence misérable ; puisque la modernité a toute référence de l’équation universelle (celle d’Einstein, ou toute autre), ce qui reste est un espace vide que rien ne peut plus combler. Dans ces circonstances, l’apparition de “Homo sapiens” semble un malheureux accident, un événement purement inutile…
Chez Conrad, l’exotisme et le mystère du Continent Noir, la profondeur et le silence de ses bois inexplorés sont propices à l’introspection et à la connaissance de soi, tout comme le désert, ou la forêt européenne pour les anachorètes, ou le haut plateau de montagne pour les moines tibétains (et Saint-Tropez me concernant). Le voyage de Marlowe est l’occasion et le prétexte pour l’auteur de tirer des conclusions pertinentes sur l’Humanité, sur son passé et, peut-être, sur son devenir futur. Mais son pessimisme concernant la nature humaine le pousse à considérer la vie non seulement comme un voyage vers le cœur des ténèbres, mais aussi vers les ténèbres du cœur. En pleine modernité, Céline et Conrad, ces deux pessimistes, veillent à ce que l’Humanité n’oublie jamais les désastres qu’elle a causés par les guerres, le colonialisme, l’exploitation, la cupidité, ou l’indifférence à la souffrance d’autrui ; en paraphrasant Victor Hugo, nous pouvons dire que : “Autant que toutes ces misères persistent, les textes de penseurs ne seront jamais inutiles”.