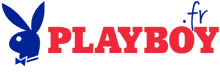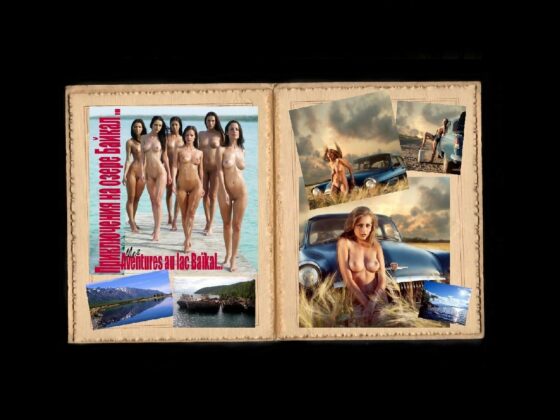Le mystère Edouard Stern… #4
Analyse psychologique de Cécile Brossard.
Mystiques et libertés sado-maso.
Par le professeur W. Velge.
Comme l’ont montré les analyses du Cercle de Vienne, et plus largement la linguistique et la philosophie analytique, les notions métaphysiques sont en fait dépourvues de signification.
En effet, les mots n’ont pas de sens en eux-mêmes, ils n’ont de sens que par rapport à d’autres mots, dans des contextes de mots et d’énonciation de ces mots par des sujets humains.
Les mots n’ont pas de sens en-soi, ils n’ont de sens que par rapport à ceux qui les prononcent.
Comme pour tous les mots, le sens du mot « liberté » se rapporte donc non pas à une signification propre et objective mais à l’intention du sujet parlant lorsqu’il utilise ce mot.
Comprendre ce que signifie ce mot suppose donc de comprendre ce que veut dire le sujet qui l’emploie au moment où il l’emploie, dans son contexte d’énonciation.
Le sens d’un mot est entièrement relatif à l’intention de celui qui l’emploie, c’est-à-dire à un contexte particulier d’énonciation. La liberté est une notion métaphysique.
En l’absence du discours d’un sujet auquel la rapporter, cette idée est donc une pure abstraction langagière.
Comprendre la signification d’une idée suppose de comprendre la valeur qu’elle prend au sein d’un discours formulé par un sujet.
Que signifie telle idée dans tel contexte d’énonciation, c’est-à-dire finalement pour telle personne ?
Il y a donc autant de libertés que de sujets parlants.
Pour définir ces multiples libertés, il faut définir qui parle et que veut dire « liberté » pour qui parle.
Une typologie des sujets nous donnera ainsi du même coup une typologie des libertés.
En effet, tout le monde n’a pas la même idée de ce qu’est la liberté.
Le sentiment d’être libre varie en fonction de la personnalité et de la psychologie des individus.
A chacun sa liberté.
La notion de liberté doit donc être analysée à la lumière de ce que nous savons de la subjectivité des êtres qui la réclament ou qui l’éprouvent. Liberté et « double-nature » humaine…La liberté n’est pas une, pas plus que la subjectivité humaine.
Ni l’une ni l’autre ne possède une nature, une essence unifiée.
Notre hypothèse est que cette subjectivité humaine est doublement polarisée par des tendances sadiques et masochistes.
Les sujets sadiques auront une autre définition de la liberté que les sujets masochistes.
La liberté n’existant pas comme un objet en-dehors des sujets qui en parlent, elle change donc de nature en fonction de la définition qu’on en donne.
Il existe au moins deux types de libertés, celle du sadique que nous appellerons apollinienne car elle tend à renforcer le principe d’individuation, et celle du masochiste que nous appellerons dionysiaque car elle tend à dissoudre ce même principe d’individuation.
Les termes apollinien et dionysiaque apparaîtront ici dans un sens conforme à celui de Nietzsche (La naissance de la tragédie) ou à celui de l’anthropologue Ruth Benedict. La liberté n’est pas une notion morale mais plutôt une façon d’exprimer son désir : vers la promotion de l’ego ou vers la dissolution de l’ego.
Pour comprendre ce qu’est la liberté, il faut l’envisager à partir d’un système relationnel dominant-dominé, un rapport de forces sado-maso, une dialectique maître-esclave.
Pour la modernité post-métaphysique, le corps est essentiellement sexuel en ce qu’il est « troué », incomplet.
Selon Lacan, le corps est une surface topologique comparable à un ruban de Moebius, un lieu possédant une continuité entre l’intérieur et l’extérieur.
Cette continuité est assurée par les trous du corps.
L’intérieur du corps est ouvert sur l’extérieur par ses orifices, érogènes ou autres.
Le corps est ainsi pénétrable par l’extérieur.
Un corps peut donc être vécu de deux façons : comme intériorité pénétrable ou comme extériorité pénétrante.
Et en effet, il existe fondamentalement deux types d’expérience sexuelle du corps : pénétrer l’Autre ou être pénétré(e) par l’Autre, à quoi correspondent deux formes de désir et de liberté, sadique ou masochiste.
Mais avant d’aborder ces distinctions, revenons un instant pour mieux la déconstruire ensuite sur la conception classique du corps, du sujet et de sa liberté.
Liberté et subjectivité métaphysique…
La représentation implicite du corps dans la métaphysique est la sphère complète, autosuffisante dont la surface est impeccable, lisse, non trouée.
Les orifices du corps, ses trous, ses manques sont refoulés.
Selon ce modèle, la subjectivité est pensée comme substance homogène et autonome.
La définition classique de la liberté est donc l’autonomie, l’indépendance, la capacité pour l’individu de se déterminer lui-même sans être soumis à une influence extérieure à sa propre volonté.
C’est ce que l’on appelle le libre-arbitre.
Cette définition repose sur une conception métaphysique de la subjectivité et du corps : substance et sphère à la surface imperméable.
Dans les définitions traditionnelles de la liberté, le sujet est toujours un ego métaphysique idéal, libre de se déterminer lui-même en âme et conscience.
La conception cartésienne du sujet est ici la référence majeure : « Je pense, je suis ».
Ce que je suis s’identifie à ce que je suis capable de m’en dire à moi-même.
Ce que je suis se résorbe ainsi dans ma conscience immédiate de moi.
Le moi est une substance pensante homogène, une res cogitans claire et distincte à elle-même.
Et la liberté est l’expression autonome de la volonté de cette subjectivité. Liberté et subjectivité post-métaphysique…Dès lors que les orifices et les trous du corps sont reconnus et pris en compte, le modèle du sujet comme sphère ou substance autonome est périmé.
A cette conception du sujet comme substance complète se substitue donc au cours de la modernité celle du sujet « troué » comme instance incomplète.
Le sujet est une instance d’un processus ou d’une structure, d’un système dont il fait partie, mais qui le dépasse et dont il dépend.
Il est donc en fait divisé, hétérogène, perméable, il a perdu son unité.
En éthologue, Boris Cyrulnik parle d’individu poreux : « Le grand piège de la pensée, c’est de croire que l’individu est un être compact. L’individu est un objet à la fois indivisible et poreux, suffisamment stable pour rester le même quand le biotope varie, et suffisamment poreux pour se laisser pénétrer, au point de devenir lui-même un morceau de milieu »…
Au 20ème siècle…
A cette époque, la psychanalyse et les sciences humaines déconstruisent cette belle illusion d’un sujet autonome, de type cartésien, et nous montrent que la conscience claire et distincte de soi n’est toujours que le résultat de processus inconscients psychiques, sociaux, physiologiques liés à l’environnement.
Le sujet n’est jamais libre, il est certes imprévisible mais aussi totalement déterminé par toutes les couches inconscientes de sa personnalité qui le structurent en profondeur.
Dans le vocabulaire kantien, il n’y a jamais autonomie mais toujours hétéronomie de la volonté. La volonté est toujours déterminée par autre chose qu’elle et qui relève du monde et de ses conditionnements divers : psychiques, biologiques, sociaux, etc.
Une nouvelle représentation du corps apparaît, il est troué, en manque, dépendant de ce qui n’est pas lui : l’environnement, les autres corps.
Henri Laborit l’exprime en termes de sociobiologie et de cybernétique : « Or, ce que nous appelons liberté, c’est la possibilité de réaliser les actes qui nous gratifient, de réaliser notre projet, sans nous heurter au projet de l’autre. Mais l’acte gratifiant n’est pas libre. Il est même entièrement déterminé. Pour agir, il faut être motivé et nous savons que cette motivation, le plus souvent inconsciente, résulte soit d’une pulsion endogène, soit d’un automatisme acquis et ne cherche que la satisfaction, le maintien de l’équilibre biologique, de la structure organique »…Le sujet moderne est ainsi un sujet totalement aliéné car totalement dépendant de son environnement.
Et ce qu’il nomme liberté n’est que la possibilité d’obtenir pour lui des gratifications équilibrantes avec cet environnement.
La dépendance, l’aliénation du sujet à son environnement social et naturel peut être envisagée de divers points de vue : psychanalyse, psychologie sociale, socio(bio)logie, cybernétique, écologie, etc.
A ce sujet, Cyrulnik parle d’un véritable ensorcellement qui lie structurellement l’organisme à son environnement naturel et culturel : « Double ensorcellement pour l’homme. Pas d’autre issue que de subir le biotope structuré par la nature, puis le milieu réglé par les récits des autres »…
Mais plus encore, le sujet n’est pas seulement aliéné ou ensorcelé, il est aussi en demande d’aliénation et d’ensorcellement, en recherche d’appartenance à un groupe, à un milieu et de reconnaissance par l’altérité.
L’identité subjective humaine ne parvient à se développer que dans un jeu de reconnaissance narcissique et d’interactions mimétiques ou différenciées avec d’autres sujets.
Il n’y a de subjectivité qu’en intersubjectivité.
Je ne suis que ce que le groupe, ce que l’Autre fait de moi.
En effet, rien de ce qui me constitue ne m’appartient en propre, ne vient originellement de moi.
Le sujet ne s’auto-engendre pas, il n’est pas une substance sui generis, il est toujours le résultat involontaire d’une Histoire qui commence avant même sa naissance, il est le résultat des Autres.
Son identité biologique, son corps ne vient pas de lui, pas plus que son identité symbolique, ses souvenirs, sa mémoire.
Tout lui a été donné, tout nous a été donné par autrui, nos parents, le monde social et l’environnement naturel qui nous entourent.
En résumé, le libre-arbitre est une illusion du langage, le « Je » pensant qui se croit libre n’est que le résultat de chaînes causales complexes entre un organisme et son environnement.
Laborit expose brillamment les choses ainsi : « Comment être libre aussi quand on sait que ce que nous possédons dans notre système nerveux, ce ne sont que nos relations intériorisées avec les autres ? Quand on sait qu’un élément n’est jamais séparé de l’ensemble ? Qu’un individu séparé de tout environnement social devient un enfant sauvage qui ne sera jamais un homme ? Que l’individu n’existe pas en dehors de sa niche environnementale à nulle autre pareille qui le conditionne entièrement à être ce qu’il est ? Comment être libre quand on sait que cet individu, élément d’un ensemble, est également dépendant des ensembles plus complexes qui englobent l’ensemble auquel il appartient ? Quand on sait que l’organisation des sociétés humaines jusqu’au plus grand ensemble que constitue l’espèce, se fait par niveaux d’organisation qui chacun représente la commande du servomécanisme contrôlant la régulation du niveau sous-jacent ? »…
Le sujetsado-maso comme sujet post-métaphysique…
Cette inconsistance du moi, déjà remarquée par les Bouddhistes ou Pascal en leur temps, Lacan l’exprimera à son tour en disant que le sujet est un effet du signifiant.
L’identité du sujet humain est structurée par un ordre symbolique social qui s’imprime en lui depuis son extériorité et le marque de cette extériorité sociale, le liant ainsi aux Autres jusque dans son intimité inconsciente la plus profonde.
Autrement dit, tout ce que je suis, de mon corps à mon espace mental, je le reçois de l’Autre.
La subjectivité est fondamentalement sociale, telle est la leçon du Structuralisme.
L’identité d’ego ne peut ainsi se définir que dans sa dépendance ontologique à alter, dans son attache hétéronomique à lui.
Pour parodier Lacan, « Y’a du lien ».
Et ce lien (ou bond en anglais) entre ego et alter, ego passera toute sa vie à vouloir le reserrer.
Le bondage comme pratique sado-masochiste consistant à utiliser des liens pour enserrer le corps de l’autre, ou se faire enserrer soi-même, est en fait la pratique de communication intersubjective la plus courante.
« Attache-moi », comme dirait Pedro Almodovar…, l’univers du SM nous révèle de façon paradigmatique ce qu’est la communication humaine : création de liens doublement polarisée par l’opposition copulatoire dominant-dominé. La société est un vaste club SM.
Dès lors que nous y entrons, à la naissance, nous passons le plus clair de notre temps à pratiquer le bondage, à créer et à reserrer des liens et des attaches avec autrui, liens qui nous mettront en position dominante ou dominée par rapport à lui.
Tout individu pratique le bondage SM au quotidien avec son entourage.
La demande d’aliénation est générale.
La différence s’institue au niveau du rôle que l’individu recherche : sera-t-il aliénant ou aliéné, dominant ou dominé, actif ou passif, sado ou maso, sujet ou objet, masculin ou féminin ?
Les interactions humaines de tous les jours sont des processus d’ajustement visant à définir le rôle et la position de chacun au sein du rapport d’aliénation : serai-je ton maître ou ton esclave, ou changerons-nous de rôle alternativement ?
A la suite de Hegel, il nous semble possible de comprendre la totalité des rapports humains, excepté peut-être l’amitié, à la lumière de la dialectique du maître et de l’esclave.
Toute l’activité du sujet vise à trouver sa place dans le « donjon » social.
Je ne suis que ce que l’autre me renvoie de moi-même.
Je n’existe que dans le regard de l’autre, dans le rapport à l’autre, dans le lien à l’autre.
Et c’est au travers de la communication intersubjective que va s’élaborer ce lien.
L’essentiel du dialogue ego-alter se résume donc à « Bond me » et « Let me bond you ». Communiquer c’est bonder. Le sujet SM est ce sujet post-métaphysique poreux, structurellement bondeur, c’est-à-dire en création continuelle d’aliénation à autrui.
Le sujet SM contient les deux potentialités dominant et dominé, aliénant et aliéné.
Cependant, l’individu concret actualise tendanciellement plutôt l’une ou l’autre.
Le sujet SM se subdivise donc en sujet S, sado-dominant actif, et M, maso-dominé passif.
Dans un contexte social intersubjectif donné (un groupe, un couple, une famille, etc.), tout sujet tendra à être plutôt l’un ou l’autre, même s’il a en lui les deux virtualités.
La communication sociale comme bondage généralisé, production d’aliénation, fera émerger par un travail d’ajustements intersubjectifs les tendances S ou M des individus.
Ce qui se produira dans la sphère de la communication, ce que ego dira à alter, sera dès lors toujours une production d’aliénation supplémentaire, un lien, un ensorcellement de plus, le sujet humain en ayant besoin comme de l’air pour respirer.
Relativement à la problématique de la liberté, la question n’est donc plus de savoir qui recherche l’aliénation, la dépendance, l’hétéronomie, et qui recherche la liberté, l’indépendance, l’autonomie.
Personne ne cherche l’autonomie, c’est-à-dire la solitude.
Tout sujet est fondamentalement SM, bondeur, et ne survit que dans l’aliénation.
La question est donc davantage de savoir qui cherche à être S et qui cherche à être M.
Que dit le sujet S et que dit le sujet M ?La liberté dans l’aliénation…Comme nous l’avons déjà dit, en théorie la liberté est synonyme d’autonomie de la volonté et d’indépendance.
Idéalement, un sujet, un ego libre est capable de s’auto-déterminer lui-même sans être aliéné par un autre arbitre que lui-même, sans souffrir d’aucune hétéronomie de la volonté.
Mais si un sujet libre existe, son autonomie ontologique le place nécessairement hors de tout lien social, hors de toute communauté, donc hors de toute puissance de communication, de mise en commun.
Sa liberté ne peut donc pas s’énoncer, elle est muette et invisible.
La liberté, l’autonomie s’effondrent, s’évanouissent au moment même où le sujet communique, se produit face à l’Autre, entre dans l’intersubjectivité. Il entre par là même dans le bondage continuel de l’existence sociale et endosse inévitablement le rôle S ou M, selon ses dispositions personnelles. A vrai dire, l’autonomie est plutôt ce que le sujet humain cherche à fuir.
L’autonomie s’identifie à la solitude, l’absence de rapports et d’attaches avec les autres.
Un être théoriquement libre et autonome s’exclurait de lui-même de toute communauté, de toute koiné, et subsisterait volontairement dans son isolement idiosyncrasique.
Par principe, la liberté ne peut réellement advenir qu’en-dehors de l’existence sociale.
Or l’être humain est fondamentalement grégaire et n’a de cesse de s’intégrer et de trouver sa place dans des groupes et des sociétés.
C’est un « animal social » qui dépérit et meurt dès lors qu’il est hors-communauté.
Cyrulnik dit encore : « De tous les organismes, l’être humain est probablement le plus doué pour la communication poreuse (physique, sensorielle et verbale), qui structure le vide entre deux partenaires et constitue la biologie du liant »…
Seuls les autistes subsistent hors du lien communautaire, hors de l’aliénation sociale, hors de l’ensorcellement général.
Les autistes sont en fait les sujets les plus libres et indépendants, les moins aliénés et ensorcelés par les autres.
A l’opposé, le sujet non-autiste « normal » est en recherche perpétuelle de liens, de rapports, de relations avec ses semblables, ou des moyens de substitution : animaux de compagnie, plantes vertes, télévision, en dernier recours, un vibromasseur ou une poupée gonflable.
Le désir du sujet social ne vit que par et pour l’hétéronomie, la dépendance, l’attachement.
A ce sujet, Lévi-Strauss fait la remarque suivante : « Car c’est, à proprement parler, celui que nous appelons sain d’esprit qui s’aliène, puisqu’il consent à exister dans un monde définissable seulement par la relation de moi et d’autrui. (Telle est bien, nous semble-t-il, la conclusion qui se dégage de la profonde étude du professeur Jacques Lacan, “l’Agressivité en psychanalyse“, Revue française de Psychanalyse, n°3, juillet-septembre 1948.) La santé de l’esprit individuel implique la participation à la vie sociale, comme le refus de s’y prêter (mais encore selon des modalités qu’elle impose) correspond à l’apparition des troubles mentaux »… Que signifie donc la liberté pour un être qui ne rêve finalement que d’existence sociale et donc d’aliénation ?
Paradoxalement, la recherche de liberté doit se comprendre avec la recherche de liens et de dépendance.
La liberté ne serait pas l’autonomie mais plutôt une forme de bondage, un type de dépendance et d’attache aux autres, un type d’hétéronomie ou d’ensorcellement.
Il nous semble même que la liberté soit l’établissement d’un certain type d’aliénation mais orientée en faveur de l’ego qui la réclame.
Alors, que veut-on dire réellement lorsque l’on dit « Je veux être libre » ?
Tout ce que l’on dit, on le dit à quelqu’un, pour quelqu’un.
Tout ce que dit ego, il le dit à alter, pour alter.
La pragmatique du langage et la psychanalyse nous montrent qu’un acte d’énonciation a toujours un récepteur supposé en fonction duquel l’émetteur articule son message.
Benveniste peut ainsi noter ces quelques constats : « Dès que le pronom je apparaît dans un énoncé où il évoque, explicitement ou non, le pronom tu pour s’opposer ensemble à il, une expérience humaine s’instaure à neuf et dévoile l’instrument linguistique qui la fonde »…
Ou encore : « Mais immédiatement, dès qu’il se déclare locuteur et assume la langue, il implante l’autre en face de lui, quel que soit le degré de présence qu’il attribue à cet autre. Toute énonciation est, explicite ou implicite, une allocution, elle postule un allocutaire »…
Plus largement, toute production de signes et de sens par un ego est préparée pour une altérité susceptible de comprendre le message.
Tout ce que l’on fait, on le fait par rapport à quelqu’un.
Il y a une dimension pédagogique intrinsèque à la communication.
Un ego ne produit donc jamais du sens par hasard, dans le vide, mais toujours pour quelqu’un, pour une altérité, quelle qu’elle soit.
Un sujet ne s’exprime jamais sans l’espoir d’être entendu, sans chercher à créer du lien social, de la relation, du rapport à autrui. Le sujet Sado-apollinien : « La liberté c’est le pouvoir »…Donc, ego dit à alter « Je veux être libre ».
Quand ego dit cela, il ne veut pas dire à alter « Je veux être indépendant de toi, je veux être autonome à l’égard de toi, je ne veux plus de rapport avec toi »…
Tout ce que dit ego à alter relève du bondage et a fondamentalement pour but d’entretenir un lien social, un rapport, une dépendance avec lui et non pas de les dissoudre.
Quand ego dit à alter « Je veux être libre », il signifie à alter « Je veux un certain type de rapport avec toi, et c’est moi qui vais décider de ce type de rapport »…
Les revendications de liberté doivent donc s’interpréter au sein d’un système social, toujours comme relation d’aliénation, création ou renforcement d’un certain type de dépendance, d’hétéronomie entre les acteurs du système, et non comme recherche d’autonomie et d’indépendance, absence de rapport, sortie du système social, désaliénation.
La liberté est un type de lien social, un type de positionnement social par rapport à autrui. Quel type de rapport cherche-t-on à instaurer avec l’Autre quand on lui dit « Je veux être libre », quel positionnement social prend-on par rapport à lui ?
Il ne s’agit ni plus ni moins que d’une position dominante, un rapport de domination.
C’est-à-dire un rapport d’aliénation en ma faveur, où l’Autre sera dépendant de moi et pas l’inverse.
« Je veux être libre » ne peut jamais signifier « Je veux être autonome, je ne veux plus de rapport avec toi »…
« Je veux être libre »… signifie toujours en réalité « Je veux des rapports avec toi, mais je veux décider du type de rapports que nous aurons, selon mon désir et non pas selon le tien. Et par conséquent ton désir doit s’effacer devant le mien, ton désir doit se subordonner au mien »…
Autrement dit, « Je veux être libre » se complète par « Et tu ne le seras pas »…
Ainsi, le message implicite qu’alter doit comprendre quand ego lui dit « Je veux être libre » n’est pas « Je veux être autonome, sans rapport avec toi, indépendant de toi » mais plutôt « Je veux que nos rapports soient tels que tu seras dépendant de moi car ton désir sera soumis au mien »…
Ou encore : « J’ai besoin de toi pour pouvoir exprimer mon désir comme je le veux, ce qui suppose que ton désir obéisse au mien »…
Tout acte de communication est un acte de bondage doublement polarisé par le rapport de forces SM dominant-dominé.
Comme acte de communication-bondage, dire « Je veux être libre » vise donc à créer un rapport d’aliénation entre ego et alter, au sein duquel ego exprime le désir d’être le sujet S dominant et aliénateur.
Ainsi, quand les féministes disent aux hommes « Nous voulons être libres », elles disent en réalité « Nous voulons vous dominer »…
Quand des entrepreneurs réclament le libéralisme économique, ils disent en réalité « Nous voulons dominer les autres acteurs du système économique »…La liberté du sujet Sado est ainsi placée sous le signe d’Apollon et du principe d’individuation.
En effet, la liberté du Sado passe par son affirmation égocentrique aux dépens de l’altérité Maso avec laquelle il forme système en l’instrumentalisant.
Pour le sujet S, « Je veux être libre » = « Je veux t’attacher, je veux t’aliéner, je veux t’ensorceler », « Je veux te faire quelque chose parce que tu m’appartiens »…
Les revendications libertaires expriment le désir du sujet S de posséder le sujet M auquel il s’adresse, qui devient dès lors son objet, son instrument.
La liberté c’est donc ma liberté de te posséder.
« Tu es mon objet car je veux être libre de faire de toi ce que je veux, ce que je désire » : les féministes et les entrepreneurs libéraux ne disent rien d’autre à leurs interlocuteurs, hommes et prolétaires, réduits à l’état d’instruments de plaisir ou de travail.
Les partisans rhétoriques de la liberté en système économique, sexuel ou autre sont généralement ses adversaires sur le long terme car ils défendent en réalité leur propre liberté d’être dominants dans le système.
Ils défendent leur position de pouvoir personnelle et sont donc évidemment les ennemis de la liberté d’autrui, toujours perçue comme concurrente dans la course au pouvoir.
En revendiquant sa liberté, le sujet S ne fait que la promotion narcissique de son ego.
La liberté Sado est par conséquent de nature apollinienne au sens où elle renforce le principe d’individuation du sujet qui la revendique. Le sujet Maso-dionysiaque : « La liberté c’est l’esclavage »…Passons maintenant de l’autre côté du miroir et écoutons ce que nous dit le sujet M.
A vrai dire, ce dernier ne verbalise que rarement son désir, sa poursuite de liberté dionysiaque, mais il la pense très fort.
En effet, la liberté Maso ne se réalise que dans la servitude, elle n’est donc pas censée être revendiquée explicitement.
Pour le sujet M, la liberté coïncide avec l’obéissance, c’est-à-dire que la déresponsabilisation individuelle, l’hétéronomie de la volonté, permettent un accroissement du bien-être ressenti phénoménologiquement comme un accroissement de liberté.
Si le sujet S cherche à instrumentaliser autrui pour l’utiliser comme un objet, le sujet M quant à lui cherche à être instrumentalisé et à servir d’objet à autrui.
Certains sujets humains ne s’accomplissent qu’en étant soumis et dominés, en devenant des objets.
A vrai dire, la plupart des femmes et des hommes ne se réalisent qu’en se satellisant autour d’une autorité transcendante, un phallus symbolique ou réel dont ils reçoivent la loi passivement et qui les possède.
L’épanouissement personnel prend le plus souvent la voie de l’aliénation et de l’esclavage.
Comme La Boétie le stigmatisait déjà dans De la servitude volontaire, il y a en l’humain des pulsions qui le poussent à se mettre spontanément au service d’un maître.
Les exemples historiques ne manquent pas : le succès des religions monothéistes, des sectes de toutes sortes, l’enthousiasme des foules à suivre aveuglément un leader charismatique fascisant, les crises d’hystérie des jeunes filles aux concerts, témoignent de cette disposition masochiste spontanée à l’obéissance, de ce besoin de s’abandonner à une puissance phallique dominante.
Le besoin d’être possédé par l’Autre, donc dépossédé de soi-même, est profondément enraciné en l’humain : « Posséder est bien le mot, comme les riches et les sorciers possèdent. Ravies d’être ensorcelées, les foules adorent celui qui les subjugue »… Sorte d’analyse du milieu de la pop-music par lui-même, l’album The wall des Pink Floyd offre une intéressante réflexion sur les ressemblances troublantes qui existent entre le concert rock et les rassemblements fascistes, ressemblances basées sur l’effet de catharsis hypnotique où l’ego de chaque spectateur se dilue dans une masse satellisée autour du pivot central de la scène.
En général, toutes les manifestations collectives dansées ou carnavalesques ont pour but l’anéantissement de l’identité individuelle et traduisent le désir d’ego de devenir alter, de s’aliéner, de se décentrer de lui-même dans une fusion orgiaque avec les autres sous l’égide d’un signifiant-maître, qui peut être une idée ou un être vivant.
La fonction de l’orgie est le renforcement grégaire du lien social et non pas l’expression de libertés individuelles, comme le montre Michel Maffesoli dans un ouvrage d’une grande lucidité : L’ombre de Dionysos, contribution à une sociologie de l’orgie.
Mentionnons également les expériences menées par Stanley Milgram sur des cobayes humains, qui ont donné de la soumission à l’autorité une vérification empirique ainsi qu’une échelle de mesure scientifique précise.
Les recherches de Milgram sont devenues célèbres auprès du grand public français grâce à la séquence du film d’Henri Verneuil avec Yves Montand, I comme Icare, qui reconstitue et explique ces fameuses expériences.
Nous allons y revenir.
Donnons tout d’abord un exemple historique, qui nous est rapporté par Jean Paulhan dans sa préface à Histoire d’O, de Pauline Réage : LE BONHEUR DANS L’ESCLAVAGE
Une révolte à la Barbade…
Une singulière révolte ensanglanta, dans le courant de l’année mil huit cent trente-huit, l’île paisible de la Barbade.
Deux cents Noirs environ, tant hommes que femmes et tous récemment promus à la liberté par les Ordonnances de mars, vinrent un matin prier leur ancien maître, un certain Glenelg, de les reprendre à titre d’esclaves.
Lecture fut donnée du cahier de doléances, rédigé par un pasteur anabaptiste, qu’ils portaient avec eux.
Puis la discussion s’engagea.
Mais Glenelg, soit timidité, scrupules, simple crainte des lois, refusa de se laisser convaincre.
Sur quoi il fut d’abord gentiment bousculé, puis massacré avec sa famille par les Noirs qui reprirent le soir même leurs cases, leurs palabres et leurs travaux et rites accoutumés.
L’affaire put être assez vite étouffée par les soins du gouverneur Mac Gregor… et la Libération suivit son cours.
Quant au cahier de doléances, il n’a jamais été retrouvé.Je songe parfois à ce cahier.
Il est vraisemblable qu’il contenait, à côté de justes plaintes touchant l’organisation des maisons de travail (workhouse), la substitution de la cellule au fouet, et l’interdiction faite aux « apprentis », ainsi nommait-on les nouveaux travailleurs libres, de tomber malades, l’esquisse au moins d’une apologie de l’esclavage.
La remarque, par exemple, que les seules libertés auxquelles nous soyons sensibles sont celles qui viennent jeter autrui dans une servitude équivalente.
Il n’est pas un homme qui se réjouisse de respirer librement.
Mais si j’obtiens, par exemple, de jouer gaiement du banjo jusqu’à deux heures du matin, mon voisin perd la liberté de ne pas m’entendre jouer du banjo jusqu’à deux heures du matin.
Si je parviens à ne rien faire, mon voisin doit travailler pour deux.
Et l’on sait d’ailleurs qu’une passion inconditionnelle pour la liberté dans le monde ne manque pas d’entraîner assez vite des conflits et des guerres, non moins inconditionnelles.
Ajoutez que l’esclave étant destiné, par les soins de la Dialectique, à devenir maître à son tour, l’on aurait tort sans doute de vouloir précipiter les lois de la nature.
Ajoutez enfin qu’il n’est pas sans grandeur, il ne va pas non plus sans joie, de s’abandonner à la volonté d’autrui (comme il arrive aux amoureux et aux mystiques) et se voir, enfin ! débarrassé de ses plaisirs, intérêts et complexes personnels.
Bref, ce petit cahier ferait aujourd’hui, mieux encore qu’il y a cent vingt ans, figure d’hérésie : de livre dangereux.Livre dangereux pour notre époque toute imprégnée d’une idéologie naïve des « Droits de l’Homme » fondée sur l’autonomie de l’individu et de son libre-arbitre, sur une conception métaphysique de la subjectivité.
Reconnaître que la plupart des femmes et des hommes réclament des chaînes et un maître n’est pas politiquement correct.
Une nouvelle « Déclaration des Droits de l’Homme et de la Femme » s’impose donc, composée à partir d’une conception post-métaphysique SM du sujet.
Dans cette perspective, le droit à la liberté dans nos démocraties modernes signifie le plus souvent droit de se laisser « librement » priver de sa liberté et de son autonomie volitive.
La liberté démocratique donne le droit aux citoyens de se chercher librement un maître, dans les limites juridiques officielles imposées par l’autorité de l’Etat, et de s’abandonner à sa volonté, d’être son objet, son instrument.
Ceci explique les résultats paradoxaux obtenus par Milgram lors de ses expériences menées aux Etats-Unis.
Dans un pays aussi profondément pénétré des idéaux de liberté, le citoyen moyen devrait se rebeller contre une autorité abusive.
Mais les gens normaux sont dangereux.
Les expériences démontrent en effet que la majorité des individus sont capables de torturer leurs concitoyens dès lors qu’une autorité officielle les déresponsabilise quant aux conséquences : « Pour le promoteur de l’expérience, les résultats obtenus en laboratoire sont perturbants. Ils incitent à penser qu’on ne peut faire confiance à l’homme en général, ou plus spécifiquement, au type de caractère produit par la société démocratique américaine pour mettre ses concitoyens à l’abri des cruautés et des crimes contre l’humanité dictés par une autorité malveillante. A une très grande majorité, les gens font ce qu’on leur dit de faire sans tenir compte de la nature de l’acte prescrit et sans être réfrénés par leur conscience dès lors que l’ordre leur paraît émaner d’une autorité légitime »…Mais comment comprendre ce désir d’hétéronomie passive de la volonté comme expression d’un désir de liberté ?
Paulhan résume en quelques lignes l’essentiel des diverses motivations qui poussent le sujet M à se chercher un maître.
Ces motivations se laissent traverser par un dénominateur commun : l’oubli et la dépossession de soi-même comme liberté suprême.
La liberté comme Devenir-Autre.
Tout comme le sujet S, le sujet M ne se sent libre que dans l’aliénation, la différence résidant dans son désir d’être aliéné, instrumentalisé, dominé et non pas aliénant, instrumentalisant, dominant.
La psychologie sociale et des foules (Tarde, Le Bon, Mac Dougall, Freud, Reich, Tchakhotine, Milgram, etc.) a montré que c’est au moment où l’individu s’en remet à une autorité pour l’organisation de son existence qu’il se sent le plus libre, étant libéré de lui-même.
En effet, le sujet est un poids, une charge pour lui-même, l’existence individuelle est une contrainte de tous les instants, une somme d’angoisses, de responsabilités et de frustrations quotidiennes.
La liberté Maso consiste à quitter son statut de sujet pour un statut d’objet et d’instrument aux mains de l’Autre, le but ultime de la manœuvre étant de se quitter soi-même, de se déposséder de soi-même en se laissant posséder et manipuler par l’Autre.
Le sujet se décharge de lui-même sur l’Autre et gagne ainsi en bien-être et en confort existentiel. La liberté Maso c’est donc se libérer de soi-même, de son existence individuelle ainsi que des choix, devoirs et responsabilités qu’elle implique pour s’en remettre complètement à une entité dominante qui s’en occupera à ma place.
C’est en quelque sorte la liberté de l’enfant d’être irresponsable, immature et de se reposer sur ses parents.
A l’opposé, dans une perspective théorique métaphysico-existentialiste, la liberté est responsabilité individuelle, autonomie du libre-arbitre.
Mais elle est ressentie comme fatigante et angoissante par la plupart des sujets humains car elle les renvoie à leur solitude existentielle et au travail incessant que suppose une existence d’individu.
Tout le monde n’arrive pas à être un individu, c’est-à-dire à être seul.
Les humains tendent à fuir comme la peste tout ce qui peut leur rappeler cette liberté solitaire, comme ils se fuient eux-mêmes dans le conformisme et l’aliénation sociale.
Cette aliénation sociale s’apparente le plus souvent à une ivresse dionysiaque qui leur permet de s’oublier eux-mêmes, de se perdre dans autrui, de se laisser remplir par lui, de rompre avec le principe d’individuation en se laissant posséder par quelqu’un ou par un groupe, une foule, une masse où s’abolit le poids de leur ego.
Le principe même de l’orgie, c’est le devenir-Autre, la transgression de l’individuation.
Dans son Histoire d’O, Pauline Réage nous fait partager le vécu d’un sujet M et nous permet de comprendre ses motivations profondes : « Sous les regards, sous les mains, sous les sexes qui l’outrageaient, sous les fouets qui la déchiraient, elle se perdait dans une délirante absence d’elle-même qui la rendait à l’amour, et l’approchait peut-être de la mort. Elle était n’importe qui, elle était n’importe laquelle des autres filles, ouvertes et forcées comme elle, et qu’elle voyait ouvrir et forcer, car elle le voyait, quand même elle ne devait pas y aider, la raison de son trouble était bien toujours la même : la dépossession de soi-même »…Ainsi, pour le sujet M « Je veux être libre » signifie « Je veux me libérer de moi-même, je ne veux plus être moi, je ne veux plus m’appartenir, je veux t’appartenir. Pour me libérer de moi-même, devenir autre, j’ai besoin d’être dépossédé de moi-même par toi, j’ai besoin que tu me possèdes, que tu m’aliènes, m’ensorcelles, j’ai besoin d’être ton objet, ton instrument. Je me soumets donc à toi, je me remets entre tes mains, j’abdique volontairement ma volonté pour m’abandonner à la tienne »…
Il y a bien une dimension mystique dans cette liberté Maso.
L’Autre prend toute la place en moi comme le mystique accueille Dieu en lui et se soumet à sa volonté.
Le cheminement des mystiques est du bondage SM à l’état pur.
Le mystique passif passe son temps à prier son Dieu de l’attacher avec des liens (spirituels !) et de le pénétrer profondément.
Et la grâce, l’extase est précisément ce moment où Dieu entre dans le corps du mystique et le possède comme un démon.
Jouissance des sexes et libération…Le parallèle avec la jouissance féminine est évident.
Les femmes jouissent physiquement ou symboliquement quand les hommes entrent en elles, prennent toute la place en elles, quand ils les pénètrent, les possèdent au plus profond et qu’elles peuvent ainsi se perdre dans une « délirante absence à soi-même ».
La jouissance féminine est cette dépossession masochiste de soi par la présence et l’activité de l’Autre-le-phallus en soi.
Pour une femme, ou un homme symboliquement passif, jouir c’est s’oublier, s’abolir par l’entrée de l’Autre en soi.
La jouissance masculine phallique serait plutôt sadique et apollinienne, elle est une promotion, une érection de l’ego, un renforcement musclé du principe d’individuation.
L’homme jouit en restant lui-même et en entrant dans l’Autre en tant qu’il est lui-même.
La femme jouit en devenant « autre » parce que l’Autre entre en elle.
La jouissance féminine présente un caractère fondamentalement masochiste et dionysiaque, l’ego cherchant à s’abolir, à disparaître, à se dissoudre, à se quitter, à se fuir lui-même dans l’appartenance, l’abandon, l’ouverture complète à l’Autre : « Je m’ouvre entièrement à l’Autre, me donne à lui, il vient en moi et me pénètre le plus loin possible, il me remplit, prend toute la place en moi, ainsi je m’oublie, me dépossède et me libère de moi-même »…
L’orgasme emporte une femme très loin d’elle-même.
C’est le rôle du phallus, et c’est ce que la femme lui demande que de l’emporter loin d’elle-même, la rendre étrangère à elle-même, l’ensorceler, l’aliéner tout simplement.
« Fais-moi jouir, fais-moi devenir autre, aliène-moi, fais de moi ton objet, ta marionnette, ton instrument », demande-t-elle au phallus. Le fantasme féminin ultime est ainsi la complétude mystique absolue apportée par l’Autre-le-phallus au corps troué, poreux et incomplet.
C’est le remplissage intégral des orifices du corps, la triple pénétration, vaginale, anale et buccale, et si possible de la béance de l’intérieur du corps, que le dépôt du sperme, trace du phallus, y réalise toujours imparfaitement mais qu’un phallus y pénétrant et ressortant par la bouche accomplirait dans l’idéal.
La jouissance féminine, ou masculine anale, est la libération mystique ultime où le sujet devient objet, où le sujet cesse donc d’exister comme tel en se laissant remplir par l’Autre.
Le sujet meurt, disparaît et trouve ainsi la liberté ultime parce l’Autre a pris sa place, l’a intégralement rempli.
Ne dit-on pas que la liberté ultime est dans la mort, dans cette dépossession finale de soi-même, l’abandon terminal au grand Autre, et que l’orgasme laisse pressentir ?
Par sa présence active le phallus explose, atomise l’ego féminin, ou masculin maso, le libère de lui-même et lui fait ainsi accéder à la jouissance.
Hiroshima, mon amour : Tu me tues. Tu me fais du bien…
Un titre, deux phrases et Marguerite Duras a tout dit.
Citons aussi le célèbre passage du séminaire Encore de Lacan, où il parle d’une jouissance au-delà du phallus, jouissance « pas-tout dans le phallus » propre aux femmes ou à certains mystiques hommes.Moi, je n’emploie pas le mot mystique comme l’employait Péguy.
La mystique, ce n’est pas tout ce qui n’est pas la politique.
C’est quelque chose de sérieux, sur quoi nous renseignent quelques personnes, et le plus souvent des femmes, ou bien des gens doués comme saint Jean de la Croix, parce qu’on n’est pas forcé quand on est mâle, de se mettre du côté du “xFx.
On peut aussi se mettre du côté du pas-tout.
Il y a des hommes qui sont aussi bien que les femmes.
Ça arrive.
Et qui du même coup s’en trouvent aussi bien.
Malgré, je ne dis pas leur phallus, malgré ce qui les encombre à ce titre, ils entrevoient, ils éprouvent l’idée qu’il doit y avoir une jouissance qui soit au-delà.
C’est ça, ce qu’on appelle des mystiques.J’ai déjà parlé d’autres gens qui n’étaient pas si mal non plus du côté mystique, mais qui se situaient plutôt du côté de la fonction phallique, Angelus Silesius par exemple, confondre son œil contemplatif avec l’œil dont Dieu le regarde, ça doit bien, à force, faire partie de la jouissance perverse.
Pour la Hadewijch en question, c’est comme pour sainte Thérèse, vous n’avez qu’à aller regarder à Rome la statue du Bernin pour comprendre tout de suite qu’elle jouit, ça ne fait pas de doute.
Et de quoi jouit-elle ?
Elle jouit du phallus qu’elle n’a pas mais qui la remplit.
Elle jouit d’être abolie par la présence de l’Autre en elle.
La jouissance, l’extase est l’extinction du soi.La dialectique territoriale SM ou les vases communicants…Le système des vases communicants illustre métaphoriquement le dialogue ego-alter dans leur recherche respective de liberté.
Les vases communicants fonctionnent en système dialectique d’aliénation.
Le vase ego dépend entièrement du vase alter et vice versa.
Leur différence Yin-Yang n’existe que sur la base d’une dépendance qui les oblige à communiquer, à bonder, à s’aliéner mutuellement.
La dialectique sado-maso de la liberté peut être reformulée en termes de rapports de force territoriaux.
Et ces rapports de force reposent sur le principe des vases communicants : « Plus j’en ai, moins tu en as. Moins j’en ai, plus tu en as »…
En d’autres termes, « Plus mon territoire s’étend, plus le tien se rétrécit, et inversement »…
C’est une nouvelle version du vieil adage « Ma liberté s’arrête où commence celle des autres »…
Le sentiment de liberté est quantifiable, il possède une base matérielle car il est strictement coextensif à mon espace territorial.
Le territoire d’ego est sa sphère de pouvoir et d’influence, son domaine de dominance.
Il possède une frontière au-delà de laquelle commence le territoire de l’Autre.
Le sentiment de liberté du sujet Sado correspond à la promotion apollinienne de son ego, c’est-à-dire à l’extension de son domaine territorial, donc à la transgression des frontières de l’Autre : « Je vais en l’Autre, j’entre en lui »…
Le sentiment de liberté du sujet Maso correspond à la dissolution dionysiaque de son ego, c’est-à-dire à l’occupation de son domaine territorial, donc à la transgression de ses propres frontières par l’Autre : « L’Autre vient en moi, il entre en moi »… Le sujet S se sent libre quand il jouit de pouvoir avoir l’Autre.
Le sujet M se sent libre quand il jouit de pouvoir être l’Autre.
La dialectique territoriale des vases communicants recoupe ainsi très exactement le mode d’expression du désir de chaque sujet au sein du système SM.
Le sujet S désire conquérir plus d’espace territorial personnel, plus de pouvoir sur autrui.
Par ce mouvement, il cherche aussi à transgresser les frontières territoriales de l’Autre.
Le sujet M désire que son espace territorial personnel soit conquis et donc qu’autrui ait plus de pouvoir sur lui.
Il cherche ainsi à ce que ses propres frontières territoriales soient transgressées par l’Autre.
Dans les deux cas, c’est la transgression, le viol de l’intégrité territoriale qui anime leur désir : celle de l’Autre ou la sienne propre. Le viol libérateur… Le viol et l’occupation du territoire de l’Autre ou le désir que l’Autre viole et occupe mon territoire sont les deux modalités selon lesquelles les sujets S ou M vivent leur liberté ou y aspirent.
Le concept de territoire peut se définir par trois termes : intérieur, extérieur et une frontière ou interface entre les deux.
Le territoire premier, originel, le plus intime et qui servira de modèle à tous ceux qui lui succéderont, est le corps.
La peau comme frontière territoriale permet à ego pendant le stade du miroir de se différencier d’alter en observant les limites de son corps.
Il peut alors commencer la construction de son image du moi comme intériorité opposée à l’extériorité du monde et de l’altérité en général (cf. Didier Anzieu et le « moi-peau »).
C’est la peau qui isole le moi et le différencie de tout le reste.
Le corps est un territoire, c’est même le premier de l’ego vivant, c’est-à-dire la première portion que l’ego arrache à son environnement, la première délimitation introduite par le stade du miroir dans le plérôme indistinct qui le précède. La matrice de la dialectique SM est ainsi le viol du corps, le viol sexuel.
Pour se sentir libre, c’est-à-dire dominant, le sujet S désire étendre son territoire princeps, donc son corps, au-delà de ses limites actuelles, ce qui l’amène automatiquement à transgresser les limites du territoire princeps de l’Autre, donc à violer son corps.
Pour se sentir libre, c’est-à-dire dominé, le sujet M désire l’occupation de son territoire, donc de son corps, par l’Autre qui doit pour ce faire nécessairement en transgresser les limites, en violer l’intégrité.
L’acte sexuel, où un corps pénètre dans un autre, est fondamentalement un viol au sens strict, c’est-à-dire une transgression de l’intégrité physique de l’un par l’autre, quand bien même cet acte est désiré.
Pendant le coït, les limites du corps dessinées par la peau sont en effet transgressées.
La peau n’est plus la barrière entre l’intérieur et l’extérieur puisque l’un des partenaires va à l’intérieur du corps de l’autre, sous la peau de l’autre.
Soit j’entre dans le corps de l’Autre, soit l’Autre entre dans mon corps, je vais donc sous sa peau ou il vient sous la mienne.
La jouissance du coït vient de cette altération identitaire, de cette aliénation sado-pénétrante : « J’occupe, j’envahis un autre corps que le mien, mon territoire s’étend », ou maso-pénétrée : « Mon corps est occupé, envahi par un Autre que moi, mon territoire m’échappe »…
Dans La sexualité de la femme la psychanalyste Marie Bonaparte, en se fondant sur la biologie, distingue deux types de jouissance sexuelle, une concave masochiste et une convexe sadique : La psychologie est, en effet, une branche – et combien importante pour nous nous les humains – de la biologie.Le masochisme féminin essentiel, comme nous l’avons déjà rappelé, a été mis en lumière d’abord par Freud (Das ökonomische Problem des Masochismus – Le problème économique du masochisme) (1924).
Helene Deutsch (Der feminine Masochismus und seine Beziehung zur Frigidität – Le masochisme féminin et ses rapports à la frigidité) (1930) y a ensuite cru voir la condition primordiale de l’établissement de la fonction érotique normale chez la femme.
Passive est, à travers toute la série des êtres vivants, animaux ou plantes, la cellule femelle, l’ovule, dont la mission est d’attendre que la cellule mâle, le spermatozoïde actif et mobile, vienne la pénétrer.
Mais cette pénétration implique effraction de la substance et l’effraction de la substance des vivants peut comporter sa destruction, la mort aussi bien que la vie.
La fécondation de la cellule femelle s’inaugure ainsi par une sorte de blessure : la cellule femelle est, à sa façon, primordialement « masochique ».
Or, on dirait que ces réactions prototypiques cellulaires se transfèrent en bloc au psychisme des porteurs ou des porteuses de ces mêmes cellules, et l’attitude psycho-sexuelle, en l’espèce humaine, mâle ou femelle, en apparaît toute imprégnée.Un analyste, à juste titre, a créé la formule du « pénis creux » de la femme.
La femme vaginale, quand elle jouit du pénis de l’homme en elle inclus, semble avoir dans sa plus ou moins inconsciente imagination la représentation de son propre vagin en creux, moule pour ainsi dire du pénis convoité.
Ces femmes-là ont, pourrait-on justement dire, une représentation mentale concave de la volupté qui s’oppose absolument à la représentation mentale convexe de la volupté qui est celle des clitoridiennes comme des hommes. Le sujet S jouit de ce qu’à l’extérieur des limites de son propre territoire, à l’extérieur des limites de sa peau, à l’extérieur de son corps, il est encore lui-même dans l’Autre.
A chaque fois qu’il pénètre l’Autre, l’image de soi du sujet S s’altère, se prolonge, s’étend, son principe d’individuation s’exacerbe jusqu’au paroxysme car il se sent libre par le contrôle qu’il a sur le corps de l’Autre, son territoire le plus intime.
Quant au sujet M, il jouit de ce qu’à l’intérieur des limites de son territoire, à l’intérieur des limites de sa peau, à l’intérieur de son corps, il y a maintenant deux personnes.
A chaque fois qu’il est pénétré par l’Autre, l’image de soi du sujet M s’altère, subit une transformation, le sujet M n’est plus seulement lui-même mais encore autre chose qui l’aliène, le rend autre, le soumet en lui faisant perdre le contrôle de son corps, son territoire le plus intime, et le libère ainsi du principe d’individuation.
N’en déplaise à Ovidie, la « travailleuse du sexe » philosophe, le plaisir de la pénétration vient de la soumission, surtout en levrette. Le désir de violer, de pénétrer, d’occuper et de contrôler un autre corps-territoire que le sien propre habite tout sujet S, homme ou femme phallique.
Et le désir que son corps-territoire soit violé, pénétré, occupé et contrôlé par un autre que lui-même habite tout sujet M, femme ou homme « pas-tout » phallique.
Un homme pas-tout phallique, désireux d’être pénétré par l’Autre, animé par un devenir-femme, n’est pas forcément homosexuel, pas plus qu’une femme phallique animée par un devenir-homme, mais il est en tout cas mystique.
Dans certains cas, notamment celui de Schreber, on pourrait parler de « sodomystique ».
Freud réduit Schreber à n’être qu’un vulgaire psychotique, alors qu’une profonde vérité s’exprime dans son discours, dans le fond pas si délirant que cela.
Ne dit-il pas dans ses Mémoires d’un névropathe : « Tout de même ce doit être une chose singulièrement belle que d’être une femme en train de subir l’accouplement »…
Jung, reprenant l’archétype de l’androgyne alchimique, ou Lacan pour d’autres raisons, semblent plus aptes à comprendre la dimension mystique de la bisexualité présente au cœur de la vie psychique.Parallèlement aux remarques des psychanalystes sur la jouissance des saints ou des psychotiques, citons pour mémoire Kurt Cobain, personnalité mystique pop et leader d’un groupe qui ne s’est pas appelé Nirvana par hasard.
Si l’on ajoute qu’une de ses chansons s’intitule Rape me (« Viole-moi ») et qu’elle figure sur l’album dont le titre est In utero, on se trouve face à un réseau de signes à interpréter qui laisse songeur.
Le suicide de Cobain, sujet Maso typique, fut l’acte mystique de libération ultime à l’égard de tout, y compris à l’égard de lui-même
L’orgasme dionysiaque final par lequel le signifiant Nirvana est devenu réel pour lui dans l’auto-abolition de son ego physique.
Cobain : mystique matérialiste.
D’autres artistes pop ont également fait des incursions dans ce sens : le clip censuré Happiness in slavery (dont le titre fait écho à Jean Paulhan) de Nine Inch Nails, joué par le body-artist SM Bobby Flanagan, ou encore Venus in furs sur le premier album du Velvet Underground.
Les Kama-Sutras, les différents yogas ou le Taoïsme ont jeté les bases de cette mystique des corps.
Plus récemment Bataille ou Artaud se sont aussi appropriés la question.
On pourrait citer également le travail de Costes, artiste « porno-social », comme on peut le voir sur une page de son site internet. Au cœur le plus intime des hommes et des femmes se cache ce désir secret de violer ou d’être violé(e) comme désir de jouissance et de libération mystique ultime.
Violer le corps de l’Autre, ou du moins le contrôler est l’expression physique la plus claire et directe de la liberté sadique comme pouvoir sur l’Autre.
Etre violé(e) dans son corps par l’Autre, ou du moins qu’il contrôle mon corps est l’impression physique la plus claire et directe de la liberté masochiste comme soumission à l’Autre et libération de soi-même.
Le désir de viol sexuel est un tabou social profondément refoulé.
Mais depuis son lieu de refoulement, il structure néanmoins l’ensemble des relations sociales entre les sexes, et aussi au sein d’un même sexe.
La nuit conditionne le jour.
Ce désir refoulé de violer ou d’être violé(e) reste actif et tire les ficelles des comportements quotidiens, manipulant les hommes et les femmes comme des pantins, à la manière du complexe d’Œdipe.
En référence à l’épisode mythologique du rapt sexuel des Sabines par les Romains, on pourrait parler du « complexe des Sabines ».
L’agressivité territoriale et la violence physique sont ainsi les deux piliers des relations hommes-femmes.
Ecoutons encore Marie Bonaparte : « La volupté vaginale du coït pour la femme adulte s’élève ainsi largement, à mon avis, sur l’existence et l’acceptation plus ou moins inconsciente du grand fantasme de flagellation masochique dans l’enfance. Dans le coït, la femme est, en effet, soumise à une sorte de flagellation par la verge de l’homme. Elle en reçoit les coups et souvent même aime leur violence. (…) Le langage lui-même, tout chargé qu’il est toujours de “reflets de l’inconscient”, porte témoignage de l’ensemble de ces faits. Ne qualifie-t-il pas le pénis de “verge”, ne parle-t-il pas de ses “coups” ? La sagesse populaire sait par ailleurs de toujours que les femmes aiment “être battues” »… Les relations hommes-femmes de tous les jours se font sur le modèle du coït et de la répartition SM des rôles, pénétrant et pénétrée.
Une analyse sémiologique de la mode vestimentaire féminine d’une société peut nous renseigner sur le degré de refoulement du désir de viol, qui peut être alors remplacé par le désir de contrôle du corps de l’Autre ou de mon corps par l’Autre, version soft et dé-génitalisée ou sublimée de la dialectique SM.
Une telle sémiologie nous renseigne aussi sur l’équilibre SM hommes-femmes qui travaille l’inconscient collectif d’une société.
Ainsi, les tenues suggestives et les accessoires en cuir (bottes, vestes) de nos sociétés occidentales gynécocrates fortement érotisées s’opposent aux tchadors et burkas des sociétés islamiques phallocrates refoulées où les hommes, majoritairement sujets S, contrôlent le corps des femmes, majoritairement sujets M. Dans les deux types de société, on observe une répartition archétypale inconsciente du désir des deux sexes de tenir tel ou tel rôle social, dominant ou dominé.
Aucune forme sociale existante ou ayant existé n’est due au hasard, n’est accidentelle.
Une société n’est que ce que ses membres en font.
Ainsi, l’état de la société est l’extériorisation des structures inconscientes collectives des membres majoritaires de cette société.
Il n’y a pas de contradiction entre l’état d’une société et les besoins et demandes profondes des individus qui la composent en majorité.
L’organisation d’une société reflète directement l’identité psychique, biologique et le désir de ses membres.
Goffman (1959) souligne que toute situation sociale repose sur un consensus opératoire entre les participants.
Aussi longtemps qu’elle dure, la forme actuelle d’une société exprime clairement le désir de ses acteurs et actrices majoritaires en nombre d’y jouer tel ou tel rôle, d’y occuper telle ou telle place, S ou M.
Et malheur aux minoritaires ! En guise de conclusion, formulons quelques prospectives utopistes sur la fin de l’Histoire inspirées de l’épilogue des Particules élémentaires de Michel Houellebecq ou des réflexions de certains apologues de l’homosexualité tels que Guillaume Dustan ou la féministe Monique Wittig. Dans La pensée straight notamment, Monique Wittig tente de montrer en quoi l’homosexualité lui apparaît comme le seul moyen de dépasser les rapports de domination entre les hommes et les femmes.
Sur ce point, Guillaume Dustan la rejoint, pour qui l’homosexualité est également le mode de socialité de l’avenir.
Mais l’homosexualité, quand bien même généralisée à une société entière, nous paraît insuffisante.
En effet, on observe déjà dans les couples homosexuels une reproduction de la paire SM actif-passif, masculin-féminin, dominant-dominé.
Le clivage et la répartition hétérosexuelle des rôles et des identités semble être une constante archétypale de l’esprit humain, quelle que soit son orientation sexuelle.
Plus que l’homosexualité et même que la bisexualité, c’est donc l’ « a-sexualité » qui transcendera les hiérarchies.
Mais cette a-sexualité ne sera possible que par une transformation des corps, des physiologies, des organismes que les progrès de la génétique permettront sans doute un jour. L’Histoire humaine est le produit de la dialectique SM maître-esclave, dominant-dominé.
Cette dialectique recoupe le dialogue, ou plus exactement la guerre des sexes, le conflit archétypal des genres, des instincts et des identités dans la société ou parfois dans la même personne.
Tout processus social trouve son moteur dans les rapports de force entre mâles et femelles.
L’Histoire c’est l’histoire du rapport homme-femme.
Plus largement, l’Histoire du vivant n’est que l’histoire du sexe, c’est-à-dire du mode de reproduction et d’évolution du vivant.
Sortir de l’Histoire, sortir des rapports de force dominant-dominé signifierait sortir du sexe, du mode de reproduction sexué de l’espèce, donc sortir de l’Humain, se libérer de l’Humain.
Une mystique asexuée des corps doit nous servir de guide.
La dialectique SM des sexes qui structure l’essentiel des rapports sociaux trouverait alors un terme.
L’amitié asexuée, qui peut très bien exister entre mâle et femelle, est le modèle relationnel à suivre.
L’abolition de la dualité des sexes et son remplacement par une espèce post-humaine clonée accomplirait cette mystique matérialiste asexuée.
La vraie liberté c’est l’indépendance à l’égard du sexe dans nos relations à autrui.
C’est l’amitié !
Le mystère Edouard Stern… #1
Le mystère Edouard Stern… #2
Le mystère Edouard Stern… #3
Le mystère Edouard Stern… #4
Le mystère Edouard Stern… #5
Le mystère Edouard Stern… #6
Le mystère Edouard Stern… #7
Le mystère Edouard Stern… #8